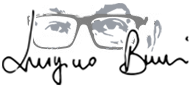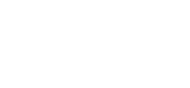Éditoriaux – L’Exhortation Apostolique « Dilexi te » du pape Léon XIV parle surtout de la mauvaise pauvreté, c'est-à-dire de la misère et de la privation, mais n'oublie pas la belle pauvreté de l'Évangile
par Luigino Bruni
publié dans Avvenire le 11/10/2025
Dans l'humanisme chrétien, le spectre du mot pauvreté est très large. Il va du désespoir de ceux qui subissent la pauvreté infligée par les autres ou par les malheurs, à ceux qui choisissent librement la pauvreté comme voie de béatitude, un choix libre qui devient souvent la voie royale pour libérer ceux qui n'ont pas choisi la pauvreté. Dans l'Église, il y a toujours eu, et il y a encore, des milliers de femmes et d'hommes qui se sont rendus pauvres dans l'espoir d'être appelés « bienheureux » (DT, n° 21) et qui, plus tard, ont compris qu'ils ne pourraient entendre cette première béatitude de Jésus qu'en devenant les compagnons de ces pauvres qui ne connaissent que le côté sombre de la pauvreté. Si donc cette pauvreté choisie, ce gage du Royaume des cieux, était éliminée de la terre par la réalisation d'un « objectif du millénaire » (n° 10), ce jour-là serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour l'humanité qui, sans la pauvreté évangélique, se retrouverait infiniment plus pauvre et misérable, même si elle ne le sait pas. L’Exhortation Dilexi te (DT) du pape Léon XIV parle surtout de la mauvaise pauvreté – que nous pourrions aussi appeler misère ou privation – pour nous inciter à en prendre soin et à ne pas « baisser la garde » (n° 12), mais elle n'oublie pas la belle pauvreté de l'Évangile, surtout dans les passages consacrées à la vision biblique de la pauvreté.
Les Évangiles et la vie nous enseignent qu'il n'est pas possible de séparer le regard et le jugement évangélique sur la pauvreté de celui sur la richesse (n° 11). La pauvreté n'est en effet pas un statut individuel, un trait de personnalité, ni « un destin amer » (n° 14). Elle est plutôt une relation erronée avec les personnes, les institutions et les biens, un mal relationnel, le résultat de choix collectifs et individuels de personnes et d'institutions concrètes. Si certaines personnes se retrouvent, sans l'avoir choisi, dans une situation de misère, cela est profondément lié à d'autres personnes et institutions qui se retrouvent avec des richesses excessives et souvent injustes, qu'elles ont presque toujours choisies. Sans pour autant aller jusqu'à dire que ta richesse est la raison de ma pauvreté - thèse qui est à la base de nombreuses envies sociales -, mais seulement reconnaître la nature essentiellement relationnelle (n° 64), sociale et politique de la pauvreté et de la richesse des hommes, et plus encore des femmes (n° 12) et des enfants. C'est pourquoi il n'est pas facile pour l'Église de parler de pauvreté et de pauvres, car il faudrait maintenir en tension vitale ces deux dimensions de la pauvreté – la bonne et la mauvaise –, car si l'on en laisse une de côté, non seulement on commet une grave erreur, mais on sort de l'Évangile. Le discours devient encore plus difficile si nous poussons jusqu'au bout la logique paradoxale des béatitudes et que nous nous rendons compte que parmi ces pauvres appelés « bienheureux » par Jésus, il n'y a pas seulement les pauvres comparables à Saint François, qui ont choisi la pauvreté, mais aussi ceux qui, comme Job, n'ont fait que la subir. Et là, il faut réussir à appeler « bienheureux » les uns et les autres, sans honte. « Heureux les pauvres » est aussi la béatitude des enfants et celle des mourants.
Les Évangiles et la vie nous enseignent qu'il n'est pas possible de séparer le regard et le jugement évangélique sur la pauvreté de celui sur la richesse (n° 11). La pauvreté n'est en effet pas un statut individuel, un trait de personnalité, ni « un destin amer » (n° 14). Elle est plutôt une relation erronée avec les personnes, les institutions et les biens, un mal relationnel, le résultat de choix collectifs et individuels de personnes et d'institutions concrètes. Si certaines personnes se retrouvent, sans l'avoir choisi, dans une situation de misère, cela est profondément lié à d'autres personnes et institutions qui se retrouvent avec des richesses excessives et souvent injustes, qu'elles ont presque toujours choisies. Sans pour autant aller jusqu'à dire que ta richesse est la raison de ma pauvreté - thèse qui est à la base de nombreuses envies sociales -, mais seulement reconnaître la nature essentiellement relationnelle (n° 64), sociale et politique de la pauvreté et de la richesse des hommes, et plus encore des femmes (n° 12) et des enfants. C'est pourquoi il n'est pas facile pour l'Église de parler de pauvreté et de pauvres, car il faudrait maintenir en tension vitale ces deux dimensions de la pauvreté – la bonne et la mauvaise –, car si l'on en laisse une de côté, non seulement on commet une grave erreur, mais on sort de l'Évangile. Le discours devient encore plus difficile si nous poussons jusqu'au bout la logique paradoxale des béatitudes et que nous nous rendons compte que parmi ces pauvres appelés « bienheureux » par Jésus, il n'y a pas seulement les pauvres comparables à Saint François, qui ont choisi la pauvreté, mais aussi ceux qui, comme Job, n'ont fait que la subir. Et là, il faut réussir à appeler « bienheureux » les uns et les autres, sans honte. « Heureux les pauvres » est aussi la béatitude des enfants et celle des mourants.
L’Exhortation Dilexi te est à la fois un appel à l'action des chrétiens et une méditation sur la pauvreté vue sous l'angle de l'Ancien et du Nouveau Testament, de Paul, des Pères, de la tradition de l'Église, avec une attention particulière pour ses charismes qui ont mis les pauvres et la pauvreté au centre, François d'Assise (n° 64) et ses nombreux amis et amies. C'est aussi une réflexion sur la pauvreté spécifique de Jésus (nn. 20-22). Il est important que cette première exhortation du pape Léon soit en pleine continuité - y compris dans son titre, qui rappelle Dilexit nos - avec le magistère du pape François sur la pauvreté (n. 3), thème central de son pontificat. Le pape François a choisi le lieu de Lazare (Lc 16) sous la table du riche glouton comme point de vue sur le monde. De là, il a vu des personnes et des choses différentes – parmi lesquelles les prisons : n° 62 – de ce que voient ceux qui regardent le monde assis à côté du mauvais riche. Avec Dilexi te, Léon nous dit alors qu'il veut continuer à regarder l'Église et le monde avec François et les Lazare de l'histoire. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Les pauvres, écrit-il, « ne sont pas là par hasard ou en raison d’un destin aveugle et amer » (n° 14), et pourtant, poursuit-il, « certains osent encore l'affirmer, faisant preuve d'aveuglement et de cruauté ». Il est important que le pape Léon, là encore dans la continuité de François, relie cette « cécité et cette cruauté » à la « fausse vision de la méritocratie », car il s'agit d'une idéologie selon laquelle « seuls ceux qui ont réussi dans la vie semblent avoir des mérites » (n° 14). La méritocratie est donc une fausse vision. L'idéologie méritocratique est, en effet, l'une des principales « structures de péché » (nn. 90 ss.) qui génèrent l'exclusion et tentent ensuite de la légitimer sur le plan éthique.
Une dernière remarque. Il existe aujourd'hui, dans la société civile, de profondes analyses sur la pauvreté non choisie. C'est celui d'A. Sen, M. Yunus, Ester Duflo (trois prix Nobel) et de nombreux autres chercheurs qui nous ont beaucoup éclairés au sujet de la pauvreté : ils ont démontré que la pauvreté est une privation de liberté, de capacités (capabilities), il en résulte une absence de capitaux (sociaux, sanitaires, familiaux, éducatifs...) qui « nous empêche de mener la vie que nous souhaitons vivre » (A. Sen). L'absence de capitaux se manifeste par une absence de flux (revenus), mais ce n'est qu'en prenant soin des capitaux que l'on pourra demain améliorer les flux. Et c'est en capitaux que devraient donc se constituer « les dons » (nn. 115 et suivants), comme le font depuis des siècles les nombreux charismes de l'Église (nn. 76 et suivants), en combattant la misère « grâce à des capitaux investis », pour construire des écoles ou des hôpitaux. Nous espérons que les futurs documents pontificaux incluront cet enseignement laïc sur la pauvreté, désormais essentiel pour la comprendre et la soigner. Et nous espérons que le monde laïc découvrira lui aussi la beauté de la pauvreté choisie. Car aux yeux du monde, même pour les meilleurs, la pauvreté n'est qu'un mal à éradiquer.
Et c'est vraiment trop peu.
Et c'est vraiment trop peu.
Credit Foto: © Diego Sarà