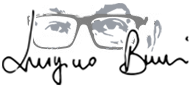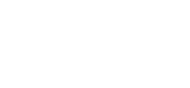Économie de la joie 6/ - Avec l'Année Sainte, nous redécouvrons la loi du repos voulu par Dieu qui nous libère des poids imposés par la vie courante.
par Luigino Bruni
publié dans Avvenire le 20/05/2025
« Si Dieu existe, il a aujourd'hui davantage besoin de quelqu'un qui, s'il ne peut pas dire qui il est, dit au moins qui il n'est pas. Dans le sens d'une destruction (ou d'une tentative de destruction) de l'idole métaphysique et impériale que nous prenons pour Dieu. La foi peut se passer de cette opération, mais elle peut aussi succomber devant ce Dieu illusoire. »
Paolo de Benedetti,Quel Dieu ?
Il existe une relation profonde entre le Jubilé et les béatitudes. Les béatitudes sont le shabbat de l'Évangile, le Jubilé de toute la Bible, l'année sabbatique de l'histoire, elles sont ce temps différent vers lequel tendent, prophétiquement, tous les autres temps. Elles sont l'annonce d'une autre joie, d'une terre promise libre et non-occupée par nos affaires et nos armes. Elles sont le « la terre du non-encore », qui juge depuis deux mille ans notre « terre du déjà » et qui la jugera toujours pour essayer de la convertir et de l'appeler à aller plu loin. Les béatitudes sont la carte pour atteindre le royaume et en sont aussi la porte, celle de ce royaume qui traverse, comme une promesse, les différentes béatitudes de Luc et de Matthieu. Elles parlent donc de cette vie, et non pas de la vie future, elles ont la saveur des fruits de notre terre d'aujourd'hui. Toute leur portée prophétique et infinie réside dans le fait qu'elles concernent « les réalités de notre terre », c'est là leur paradoxe, car elles nous parlent de nos pauvres, de nos persécutés pour la justice, de nos doux, de nos artisans de paix ; et c'est leur caractère terrestre qui nous déroute et fait qu’on les oublie, sans parler des railleries dont elles sont entourées, aujourd'hui tout comme hier.
Il est très simple de faire disparaître la prophétie des béatitudes : il suffit de les lire comme une annonce de la vie future, de la vie au-delà de la mort - les pauvres ici-bas sont misérables, mais au paradis ils seront enfin bénis. La véritable force paradoxale et extraordinaire des béatitudes réside plutôt dans le fait de penser qu'elles sont dites et écrites pour notre vie d’ici-bas, sous le soleil, pour le temps présent, pour toi, pour moi. Le royaume est une promesse pour cette terre : « ... car le royaume des cieux est à eux », un verbe conjugué au présent (« est ») et non au futur (« sera »). Il suffit de mettre ce verbe au futur pour dénaturer des béatitudes - le « verbe » dans les évangiles est un terme essentiel. Les béatitudes sont, dans l'Évangile, un mécanisme d'autoprotection contre toute tentative de faire de l'Église un club de citoyens respectueux des règles et de paisibles bien-pensants, parce que, depuis deux mille ans, elles continuent d'appeler « bienheureux » tous ceux que nous rejetons continuellement au nom de nos principes.
Le christianisme s’est investi dans de nombreuses réalités évangéliques, mais très peu dans les béatitudes. Il les a aimées, méditées, priées, chantées, mais elles ne sont pas devenues l'humanisme des chrétiens, encore moins de la Christianitas - qu'auraient pu être l'Europe et le monde, leur économie et leur politique, si la civilisation chrétienne s’était construite sur les béatitudes !Au contraire, elles ont été considérés comme une exception au sein même de l'Évangile, comme si elles étaient des invitées dans la maison d'un ami. Les chrétiens ne sont pas devenus le peuple des béatitudes ! Tout l'Évangile a été dès ses débuts un cri inaudible et un grande œuvre inachevée, nous le savons, nous le voyons, dans l'histoire et chaque jour. Mais les béatitudes sont par excellence inachevées, le comble de ce cri inaudible. Tout l'Évangile attend depuis deux millénaires d'être pris vraiment au sérieux par les communautés et les sociétés, mais au sein de l'Évangile, les béatitudes sont celles qui attendent et gémissent le plus. Les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et sont persécutés, les pacifiques, les doux ne sont pas appelés « bienheureux », y compris par les chrétiens. On n'entre pas dans la logique des béatitudes et dans leur ciel différent sans habiter leur paradoxe, sans entrer dans la logique invisible du royaume, un royaume qui perd son sel et son levain quand on veut l'expliquer et le vivre en sortant de son paradoxe essentiel, qui commence par ce « heureux les pauvres », qui est le premier de la liste parce qu'il résume tous ceux qui le suivent. En effet, le royaume est la clé pour entrer dans le « bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux » (Luc 6,20). En dehors du Royaume, non seulement les béatitudes ne sont pas comprises, mais elles sont perverties, comme le savent bien ceux qui cherchent à soulager la détresse des plus démunis et qui sont parfois gênés par des interprétations perverses de l'expression « heureux les pauvres ».
Nous sommes hors de cette terre différente qu’est le royaume. Si nous sommes honnêtes, nous le savons bien, et peut-être en souffrons-nous parfois, lorsque nous sommes saisis par un mal profond et subtil, par la nostalgie d’une autre maison. Mais nous pouvons au moins l'apercevoir de loin, si nous ne cessons pas d'y aspirer, en nous nourrissant de glands, peut-être dans des restaurants étoilés. On réalise alors que les béatitudes se comprennent à la lumière du shabbat et que le sens chrétien du shabbat se révèle à la lumière des béatitudes, dans une admirable réciprocité. Si, en effet, le Dieu de la bible et le Dieu de Jésus a voulu un jour différent tous les sept jours, si ce jour-là il a imprimé une loi qui renverse celle des six autres jours, alors les pauvres, les affligés, les endeuillés, ceux qui sont les plus malheureux selon les catégories ordinaires et les jours ordinaires de la vie, peuvent être heureux, et ils le sont, dans ce monde à l'envers qu’est le jour du shabbat. Il y a un jour où les rejetés, les vaincus et les perdants peuvent être appelés bienheureux : c'est le septième jour, et c'est un vrai nom, pas un tranquillisant. Le Jésus historique a critiqué et sapé la lettre du shabbat - il suffit de lire les évangiles pour s'en rendre compte - non pas pour nier l'une des perles de la Torah et des prophètes, mais pour affirmer une vision radicale et eschatologique du septième jour. Son shabbat, le jour véritablement et radicalement différent, est celui de ses béatitudes. Il ne s'agit pas d'une question de culte, de règles, de normes, ni d'un jour différent qui, une fois passé, est oublié dans la pratique des six autres, mais d'un jour qui arbitre tous les jours de l'histoire. Un autre monde, une autre société, une autre économie, une terre nouvelle, hors des murs, où nous pouvons installer notre poste de guet et, de là, observer notre temps, le juger sur la base de nos béatitudes oubliées, puis l'appeler à se transformer dans l'attente de ce royaume où les pauvres sont appelés bienheureux parce qu'ils le sont vraiment. Shabbat n'est pas l'exception qui confirme la règle, mais l'exception qui a le pouvoir de faire exploser la règle, s’il est vraiment pris au sérieux dans toute son ampleur.
Depuis la tour de guet du Shabbat, nous pouvons deviner que « Bénis soient les pauvres » est aussi la bénédiction des enfants et celle des mourants, ce qui nous rappelle qu’une vie digne de ce nom ne doit jamais oublier l'énorme et stupéfiante vérité du commencement et de la fin, et orienter ensuite tout son cours à la lumière de l’alpha et de l’oméga. Lors de notre dernier shabbat, nous entendrons à nouveau la voix de l'ange de la mort : « Heureux les pauvres » - et ceux qui ont réussi à préserver la vraie pauvreté jusqu'à la fin se verront bénis avec ce très beau nom.
Si les béatitudes sont le dévoilement du royaume des cieux, elles sont donc essentielles, sachant que que le cœur de l'annonce de Jésus réside dans l'attente continuelle de la venue imminente de son royaume. Le chrétien est quelqu'un qui se couche le soir avec l'espoir que le lendemain le royaume arrivera enfin, que le Ressuscité reviendra, et qui, dès qu'il se réveille, s'attriste s'il n'est pas encore arrivé. Puis il continue à espérer, à travailler dans l'attente et, le lendemain, il se rendort avec le même rêve d'espoir : c'est l'espérance chrétienne.
Tout le royaume des cieux se trouve dans le court laps de temps du septième jour, parce que la logique du shabbat change la nature du temps et le lie à l'espace. De même que l'entrée dans le jour du shabbat - acte marqué sur l'axe du temps - rompt le rythme linéaire du temps et le fait devenir autre chose, de même le franchissement du seuil du temple - acte marqué sur l'axe de l'espace - fait entrer le croyant dans un autre temps qui n'est plus régi par l'impitoyable loi de Kronos. Le Shabbat est le temple du temps. C'est pourquoi il a sauvé le peuple d'Israël en exil : ces déportés, expatriés et privés de leur temple détruit, entraient chaque semaine dans le temple en entrant dans le jour du shabbat - « Shabbat shalom ».
La prophétie de François, avec son œconomia différente, ne peut être comprise que si nous la regardons en demeurant dans cette première béatitude, en positionnant notre âme entre « bénis soient les pauvres... » et « ... car le royaume est à eux ». François voulait devenir un habitant de ce royaume de l'Évangile, et pour cela il a épousé la plus grande pauvreté, qu'il considérait comme le bon moyen de le trouver et d'y entrer. Tel est le miracle de François, tel est son paradoxe et le scandale de sa fécondité. Si nous ne l’abordons pas à la lumière du Royaume et des Béatitudes, nous déformons son mystère et nous finissons par dire que François était pauvre mais pas « démuni », qu'il aimait la pauvreté mais pas la « misère », qu'il était quelqu'un qui allait vers les pauvres « pour les aider » - en ce sens la splendide parabole du Bon Samaritain ne nous aide pas à comprendre François. L'Évangile meurt chaque fois que nous voulons le ramener dans la logique du bon sens, de la prudence, de l'équilibre, de la juste mesure. Nous le faisons tous les jours, et en fait tous les jours l'évangile meurt, et ressuscite rarement .
Le Jubilé est vraiment le temps des béatitudes. Ce jour pourrait, devrait être vraiment différent. Il nous est donné pour comprendre que nous oublions les béatitudes en ne remettant pas les dettes, en ne libérant pas les esclaves, en laissant nos désirs fous asphyxier de plus en plus la terre. Et ensuite, chaque soir, continuer à rêver à l'avènement d'un autre royaume. Sans jamais s'arrêter.