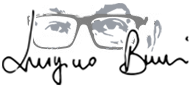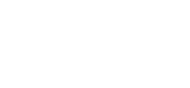Économie de la joie 3/ La culture du Jubilé est profondément ancrée dans la Bible, comme dans les deux épisodes cruciaux du Livre de Néhémie.
par Luigino Bruni
publié dans Avvenire le 08/04/2025
La culture jubilaire ne se trouve pas uniquement dans les textes qui réglementent expressément le Jubilé ou l'année sabbatique. Dans plusieurs livres de la Bible, il existe en effet des passages qui contiennent des dimensions décisives pour comprendre l'humanisme du jubilé. Après avoir analysé le livre de Jérémie, nous allons maintenant examiner de plus près un chapitre du Livre de Néhémie, haut fonctionnaire (échanson) à la cour du roi perse Artaxerxès (465-424 av. J.-C.). Néhémie était un Juif laïc né en exil qui, comme Esther, a accédé aux plus hautes fonctions de la cour, avant de devenir gouverneur de la Judée sous l'occupation perse. Alors qu'il se trouve à Suse, Néhémie apprend la condition misérable des Juifs de Jérusalem : « Ceux qui ont échappé à la captivité et qui sont restés là-bas dans la province sont dans une grande détresse et dans la honte ; le rempart de Jérusalem n’est que brèches, et ses portes ont été dévastées par le feu. » (Ne 1, 3). Néhémie entend un appel (ch. 2), il demande au roi d'être envoyé à Jérusalem pour la reconstruire. Lorsque, en effet, une partie des exilés à Babylone rentra chez elle, la coexistence avec les Juifs restés à Jérusalem ne fut pas facile. Tout d’abord pour des raisons économiques et patrimoniales évidentes : les terres des déportés étaient passées, au moins en partie, aux familles restées sur place et étaient soudain revendiquées ; mais il y avait aussi des raisons théologiques et religieuses : ceux qui avaient échappé à la déportation avaient tendance à traiter les déportés comme des coupables qui avaient mérité l'exil (ce qui est très courant dans de nombreuses communautés).
Alors que Néhémie commence à reconstruire les murs et la dignité de son peuple à Jérusalem, son livre relate un épisode très important : « Une grande plainte s'éleva du peuple et de ses femmes contre leurs frères juifs. Certains disaient : "Nos fils et nos filles sont nombreux ; prenons du grain pour manger et vivre." Néhémie fut très indigné par ce qu'il entend. Puis il se tourna vers les notables et les magistrats : "Exigez-vous donc un intérêt entre frères ?" Il convoqua son peuple et lui dit : "Ce que vous faites n'est pas juste... Remettons cette dette ! Rendez-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que les intérêts du blé." Ils répondirent : "Nous rembourserons et nous n'exigerons plus rien d'eux ". Alors, toute l'assemblée dit “Amen” et loua le Seigneur. Le peuple tint parole » (5,1-13). Un merveilleux amen économique et financier, tout à la fois profane et spirituel.
Le cri des « femmes » aux hommes de la communauté est également très important. Des paroles fortes venues de loin qui devraient nous faire réfléchir sur une constante douloureuse de l'histoire humaine. Il s'agit de l'infinie douceur et de la patience héroïque des épouses et des femmes qui, au cours des millénaires, ont subi la violence des guerres déclenchées par des hommes, et continuent de le faire. Une profonde et vaste souffrance féminine, impuissante et innocente, qui traverse les lieux et les époques, toutes les cultures. Un héritage éthique colossal de l'humanité, une douleur collective millénaire, qui mériterait au moins le prix Nobel de la paix, décerné aux femmes d'hier et d'aujourd'hui, qui ont non seulement entretenu la paix et combattu dans leurs foyers et sur les places toutes les guerres, mais qui ont été et sont les premières à souffrir dans leur corps et dans leur âme de la dévastation et des atrocités de toutes les guerres. Les hommes ont fait et font la guerre sur les champs de bataille et dans les engins de mort, les femmes la font dans leur chair et dans celle de leurs fils et de leurs maris : une souffrance doublée, multipliée, infinie. « J'ai toujours à l'esprit ce qu'a dit Teresa Mattei, la plus jeune des vingt-et-un constituants : lors du vote de la Constitution, et plus précisément de l'article 11 concernant la répudiation de la guerre, les femmes, quelle que soit leur appartenance politique, se sont prises par la main. Je suis encore émue lorsque je lis ce souvenir. » (Lucia Rossi, Secrétariat Spi-CGIL). Une image magnifique de la grande et tenace alliance des femmes pour la paix, pour exprimer, avec le langage silencieux de leur corps et de leurs mains, leur rejet absolu de la guerre. Cette splendide solidarité entre les femmes qui survit encore, difficilement, mûrie au cours des siècles pendant les guerres, lorsqu'elles ont appris à garder la vie et l'espoir dans un monde d'hommes qui les tuaient mille fois avec des armes, des gestes et des mots erronés - le premier pouvoir est toujours celui du langage par lequel tous les discours sont écrits et tous les mots sont contrôlés. Cette protestation et cette résistance des femmes nous révèlent une autre dimension fondatrice de la culture jubilaire, que nous avons oubliée tout au long de l'histoire de la chrétienté en reléguant les femmes au rôle de figurantes dans les coulisses des églises, dans les chorales, dans les « amens » liturgiques, dans les files des processions.
Cet acte de Néhémie et des femmes est donc l'un des plus beaux épisodes de la Bible qui nous dit, entre autres, que la grande douleur de soixante-dix ans d'exil babylonien n'avait pas suffi pour que les lois mosaïques sur l'interdiction du prêt à intérêt deviennent une culture répandue au sein du peuple - tout comme il ne suffit pas aujourd'hui de mettre quelques femmes en politique pour changer la culture de la guerre. Les péchés économiques se sont poursuivis même après le retour dans la patrie (538 av. J.-C.). Mais du grand traumatisme de l'exil le long des fleuves de Babylone, le peuple avait appris l'importance essentielle de la culture du shabbat et donc de la remise des dettes et de la libération des esclaves. La Bible est aussi la gardienne secrète et discrète de quelques gestes différents, parfois d'un seul, pour que nous puissions les transformer en semences.
Ce grand épisode ne prend tout son sens que si nous le lisons en parallèle avec le chapitre 8 du même Livre de Néhémie, dans l'un des passages les plus connus et les plus importants de toute la Bible, qui met en scène le prêtre Esdras.C'est un moment déterminant de la refondation religieuse et communautaire du peuple, d'une rare force lyrique. Le voici : « Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place devant la porte des Eaux et dit au scribe Esdras d'apporter le Livre de la Loi de Moïse... Esdras apporta la Loi devant l'Assemblée des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de comprendre... Quand Esdras ouvrit le livre, tout le peuple se leva. Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répondit : Amen, amen, en levant les mains... Tout le peuple pleurait en écoutant les paroles de la Loi » (chap. 8, 1-9). Encore un amen, un bel amen - comme il serait merveilleux de pouvoir répéter l'un de ces « amen » comme dernier mot sur cette terre !
Nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de lieu plus liturgique pour proclamer la parole de Dieu qu'une rue, une place ou un marché. Cette place devant la Porte des Eaux nous rappelle la première petite tente qui, sur les pentes du Sinaï, recouvrait l'Arche d'Alliance qui contenait les tablettes de la Torah. Cette tente devint un jour le grand temple de Salomon, mais dans le peuple, la nostalgie de cette première tente mobile, de sa pauvreté et de sa liberté, quand « il n'y avait qu'une seule voix », ne s'était jamais estompée. Et c'est là que se trouve la racine de la prophétie qui clôt la Bible : dans la nouvelle Jérusalem, « je n'ai pas vu de temple » (Ap 21,22), et « l'arbre de vie » se trouvait « au milieu de la place de la ville » (22,2).
Ce récit n'est pas seulement un point (peut-être le point) à l’origine de la tradition de l'utilisation liturgique et communautaire de l’Écriture ; c'est aussi le don de la parole, de la Torah au peuple tout entier - la lecture a duré de nombreuses heures, et tous se sont levés. Ce n'est plus le monopole des scribes et des prêtres, la parole devient ici l’élément essentiel d'un nouveau pacte social, d'une résurrection collective - le mot peuple est répété douze fois. Et l'exil est vraiment terminé. Il y a eu d'autres moments de transmission de la parole dans l'histoire d'Israël. Mais la Bible a voulu nous donner ce moment particulier, un acte solennel présenté avec la même force qu'un testament, pour marquer le début d'un temps nouveau, qui peut être le nôtre.
Il y a aussi un détail important : cette assemblée du peuple a lieu « sur la place de la porte des Eaux ». Cet événement liturgique et spirituel décisif n'a donc pas lieu dans le temple, ce qui nous indique que la Parole a priorité sur le temple - rappelons qu'à Jérusalem, le temple n'avait jamais cessé de fonctionner. Nous trouvons donc dans ce passage un fondement de la véritable laïcité biblique: la Parole peut être proclamée, peut-être doit-elle être proclamée sur la place, au milieu des rues de la ville, où elle continue ensuite à marcher en « procession » - une procession civile qui rappelle celles qui ont eu lieu lors de la fondation des premiers Monts de Piété au XVe siècle. Depuis ce jour, nous savons qu'il n'y a pas de lieu plus liturgique pour proclamer la parole de Dieu qu'une rue, une place, un marché. Cette place devant la Porte des Eaux nous rappelle la première petite tente qui, sur les pentes du Sinaï, recouvrait l'Arche d'Alliance contenant les tablettes de la Torah. Cette tente devint un jour le grand temple de Salomon, mais dans le peuple, la nostalgie de cette première tente mobile, de sa pauvreté et de sa liberté, quand « il n'y avait qu'une seule voix », ne s'était jamais estompée. Et c'est là que se trouve la racine de la prophétie qui clôt la Bible : dans la nouvelle Jérusalem, « je n'ai pas vu de temple » (Ap 21, 22), et « l'arbre de vie » se trouvait « au milieu de la place de la ville » (22, 2).
Revenons maintenant à la culture du Jubilé. Le nouveau fondement liturgique de la communauté, la laïcité de la place qui l'emporte sur le caractère sacré du temple, est préparé par le pacte économique et social de la remise des dettes, généré par le cri des femmes au chapitre 5. Néhémie a d'abord rétabli la communion et la justice dans l'ordre des relations sociales, des biens et des dettes, et ensuite seulement il a rétabli la liturgie et donné la parole. Un message d'une grande valeur. Néhémie a fait l'assemblée sur la place parce que cette assemblée liturgique était déjà une assemblée politique et sociale.
Les réformes religieuses, liturgiques, « spirituelles » qui ne sont pas précédées de réformes économiques, financières et sociales ne sont pas seulement inutiles : elles sont extrêmement nuisibles parce qu'elles finissent par donner un chrême sacré à l'injustice, aux mauvaises relations sociales et aux abus.
Même notre jubilé ne passera pas en vain si, avant de franchir les portes saintes et les indulgences plénières, nous sommes capables de nouveaux pactes sociaux, d'annuler quelques dettes, de libérer au moins un esclave, d'écouter le cri des femmes et des pauvres. Mais, jusqu'à présent, ces actes jubilaires ne semblent pas figurer à l'ordre du jour de nos communautés.